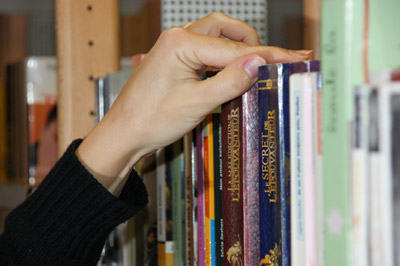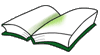Bibliothèque CREDIMI
RĂ©sultat de la recherche
6 recherche sur le mot-clé
'primauté' 



 Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
Titre : L'organisation du sport par le contrat Titre original : Essai sur la notion d'ordre juridique sportif Type de document : texte imprimé Auteurs : Gaylor RABU, Auteur Editeur : Presses universitaires d'Aix-Marseille Année de publication : 2010 Importance : 646 pages Format : Broché ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7314-0717-4 Langues : Français (fre) Catégories : Droit commun des contrats
Droit du sportMots-clés : droit du sport contrat organisation ordre juridique sportif instrument autorégulation conciliation d'intérêt primauté relativité Index. décimale : 344.440 99 : Divertissement Résumé : Le recours au contrat comme technique d'organisation du sport révèle l'existence d'un véritable ordre juridique sportif. D'une part, le contrat fonde l'ordre juridique sportif. Les groupements sportifs sont construits sur la base d'un contrat original : le contrat-organisation, issu de la conjonction de la liberté contractuelle et de la liberté d'association. Il confère aux parties des pouvoirs normatifs et disciplinaires qui vont s'imposer aux membres.
Les groupements sportifs vont ensuite structurer leurs relations grâce au contrat, tant au niveau national, que transnational. D'autre part, le contrat n'est pas seulement la source des autonomies organique et sociale du secteur sportif. Il permet également son autorégulation par la conciliation contractuelle des intérêts sous la forme de conventions collectives et par la réconciliation contractuelle des intérêts réalisée grâce à la construction d'un arbitrage sportif.
L'ordre juridique sportif ainsi consacré, s'il est autonome par nature, entretient néanmoins des rapports de dépendance à l'égard de l'ordre juridique étatique. Celui-ci s'efforce d'assurer sa primauté de deux manières : il instaure une relation tutélaire avec l'ordre juridique sportif, que ce soit par la programmation partielle de la liberté contractuelle des fédérations ou de leurs membres ; il procède également au contrôle de légalité, veillant au respect des dispositions de l'ordre public économique et non-économique.
Toutefois, cette relation de dépendance doit être relativisée à double titre. D'une part, les sujets de l'ordre juridique sportif s'attachent à en préserver l'autonomie. Le rapport de force est négocié jusqu'à s'inverser parfois. D'autre part, les juges et arbitres sportifs participent tous deux de la combinaison des deux ordres juridiques.L'organisation du sport par le contrat = Essai sur la notion d'ordre juridique sportif [texte imprimé] / Gaylor RABU, Auteur . - Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2010 . - 646 pages ; Broché.
ISBN : 978-2-7314-0717-4
Langues : Français (fre)
Catégories : Droit commun des contrats
Droit du sportMots-clés : droit du sport contrat organisation ordre juridique sportif instrument autorégulation conciliation d'intérêt primauté relativité Index. décimale : 344.440 99 : Divertissement Résumé : Le recours au contrat comme technique d'organisation du sport révèle l'existence d'un véritable ordre juridique sportif. D'une part, le contrat fonde l'ordre juridique sportif. Les groupements sportifs sont construits sur la base d'un contrat original : le contrat-organisation, issu de la conjonction de la liberté contractuelle et de la liberté d'association. Il confère aux parties des pouvoirs normatifs et disciplinaires qui vont s'imposer aux membres.
Les groupements sportifs vont ensuite structurer leurs relations grâce au contrat, tant au niveau national, que transnational. D'autre part, le contrat n'est pas seulement la source des autonomies organique et sociale du secteur sportif. Il permet également son autorégulation par la conciliation contractuelle des intérêts sous la forme de conventions collectives et par la réconciliation contractuelle des intérêts réalisée grâce à la construction d'un arbitrage sportif.
L'ordre juridique sportif ainsi consacré, s'il est autonome par nature, entretient néanmoins des rapports de dépendance à l'égard de l'ordre juridique étatique. Celui-ci s'efforce d'assurer sa primauté de deux manières : il instaure une relation tutélaire avec l'ordre juridique sportif, que ce soit par la programmation partielle de la liberté contractuelle des fédérations ou de leurs membres ; il procède également au contrôle de légalité, veillant au respect des dispositions de l'ordre public économique et non-économique.
Toutefois, cette relation de dépendance doit être relativisée à double titre. D'une part, les sujets de l'ordre juridique sportif s'attachent à en préserver l'autonomie. Le rapport de force est négocié jusqu'à s'inverser parfois. D'autre part, les juges et arbitres sportifs participent tous deux de la combinaison des deux ordres juridiques.Réservation
RĂ©server ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 2208 XXIII 2010 RAB Livre CREDIMI 301 XXIII - Droit du sport Disponible
Titre : L'américanisation du droit de la concurrence Titre original : Jusqu'où ? Type de document : texte imprimé Auteurs : Louis VOGEL , Auteur
Editeur : Panthéon-Assas Année de publication : 2020 Importance : 282 pages Format : Broché ISBN/ISSN/EAN : 978-2-37651-018-5 Langues : Français (fre) Catégories : Droit économique, droit du marché Mots-clés : droit de la concurrence sociologie histoire américanisation législation anti-trust mondialisation droit comportements tradition européenne concepts juridiques importance contrôle des concentrations politiques publiques impact primauté action publique sur action civile politique industrielle ou économique Index. décimale : 343.072 1 : Droit de la concurrence (législation antitrust) Résumé : Les circonstances de l'après-guerre, qui lui ont conféré une position de force, ont fait que le droit américain a entraîné une transformation, non voulue à l'origine, des droits européens. Cette « américanisation », qui a débuté avec l'adoption des droits européens de la concurrence et qui se poursuit de nos jours, rencontre toutefois des limites. D'un point de vue comparatif, elles sont les plus intéressantes à examiner car elles révèlent l'essence des systèmes juridiques européens. À l'opposé du droit américain, qui accorde toujours davantage d'importance aux effets plutôt qu'aux comportements, les droits européens attribuent un rôle déterminant à ces derniers. De même, les droits européens conceptualisent, en règle générale, des notions que le juge américain applique sous la forme de doctrines jurisprudentielles. Enfin, en Europe, les droits de la concurrence sont aujourd'hui encore perçus comme des moyens de l'intervention publique, essentiellement appliqués par des autorités administratives, plutôt que comme la résultante d'actions juridiques mises en oeuvre par des opérateurs privés. Les îlots de résistance à l'américanisation manifestent la quintessence des systèmes juridiques européens, plus subjectifs, plus abstraits et plus étatistes que le droit américain. Ces différences qui affectent des règles extrêmement proches dans le temps et dans leur substance montrent que la structure et la vie des règles, loin d'obéir seulement à la fonction de contrôle qui leur est assignée, dépendent en réalité très largement du contexte socio-historique dans lequel elles naissent et se développent. L'américanisation du droit de la concurrence = Jusqu'où ? [texte imprimé] / Louis VOGEL, Auteur . - Panthéon-Assas, 2020 . - 282 pages ; Broché.
ISBN : 978-2-37651-018-5
Langues : Français (fre)
Catégories : Droit économique, droit du marché Mots-clés : droit de la concurrence sociologie histoire américanisation législation anti-trust mondialisation droit comportements tradition européenne concepts juridiques importance contrôle des concentrations politiques publiques impact primauté action publique sur action civile politique industrielle ou économique Index. décimale : 343.072 1 : Droit de la concurrence (législation antitrust) Résumé : Les circonstances de l'après-guerre, qui lui ont conféré une position de force, ont fait que le droit américain a entraîné une transformation, non voulue à l'origine, des droits européens. Cette « américanisation », qui a débuté avec l'adoption des droits européens de la concurrence et qui se poursuit de nos jours, rencontre toutefois des limites. D'un point de vue comparatif, elles sont les plus intéressantes à examiner car elles révèlent l'essence des systèmes juridiques européens. À l'opposé du droit américain, qui accorde toujours davantage d'importance aux effets plutôt qu'aux comportements, les droits européens attribuent un rôle déterminant à ces derniers. De même, les droits européens conceptualisent, en règle générale, des notions que le juge américain applique sous la forme de doctrines jurisprudentielles. Enfin, en Europe, les droits de la concurrence sont aujourd'hui encore perçus comme des moyens de l'intervention publique, essentiellement appliqués par des autorités administratives, plutôt que comme la résultante d'actions juridiques mises en oeuvre par des opérateurs privés. Les îlots de résistance à l'américanisation manifestent la quintessence des systèmes juridiques européens, plus subjectifs, plus abstraits et plus étatistes que le droit américain. Ces différences qui affectent des règles extrêmement proches dans le temps et dans leur substance montrent que la structure et la vie des règles, loin d'obéir seulement à la fonction de contrôle qui leur est assignée, dépendent en réalité très largement du contexte socio-historique dans lequel elles naissent et se développent. Réservation
RĂ©server ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© 1839 VIII 2020 VOG Livre CREDIMI 301 VIII - Droit économique, droit du marché Disponible
Titre : La crise de la loi Titre original : Déclin ou mutation ? Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre ALBERTINI, Auteur Editeur : LexisNexis Année de publication : 2015 Collection : Essais Importance : 366 pages Format : Broché ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7110-2216-8 Langues : Français (fre) Catégories : Sources du droit et ouvrages généraux en droit Mots-clés : lois rédaction législative crise déclin mutation légistique notion de loi fonctions de la loi transformations enjeux finalités sécurité juridique stabilité accessibilité égalité liberté justice primauté volonté générale bloc de constitutionnalité subordination contrôle de conventionnalité élaboration de la loi évaluation préalable insuffisance travail parlementaire imperfections contenu de la loi accès à la loi application de la loi revalorisation de la loi Index. décimale : 348.440 2 : Lois et règlements - France Résumé :
Au coeur de toute société ordonnée, la réflexion sur la loi, longtemps imprégnée de considérations métaphysiques, apparaît, sous sa forme moderne, avec Montesquieu et Bentham : elle reçoit une consécration majestueuse avec la Déclaration de 1789. Pièce maîtresse de la "garantie des droits" jusqu'à la Ve République, elle est désormais concurrencée, partout, par le constitutionnalisme et, en Europe, par le droit communautaire. L'amélioration de la qualité de la loi, tant dans l'écriture que sur le fond, explique l'émergence d'une discipline nouvelle, la légistique, dont le statut-art ou science ? - divise la doctrine.
Déclin ou mutation de la loi ? Tel est le fil conducteur de l'ouvrage. Ce dernier replace d'abord l'évolution de la loi dans le cadre plus général de la transformation du droit, dont elle est l'un des outils. Les questionnements philosophique et juridique sur la finalité et les fonctions de la loi conduisent ensuite à en dresser la "pathologie" : surcharge de détails, perte de clarté, application malaisée dessinent une cartographie des insuffisances et des risques, sous l'angle de l'accès à la loi et de ses effets.
Malgré les progrès réalisés en 2008-2009, l'évaluation législative demeure largement perfectible, comme le montrent les nombreuses pistes ouvertes par l'auteur, qui s'inspire de son expérience personnelle et d'exemples étrangers significatifs (canadien, suisse, britannique). Concluant à la mutation de la loi et non à son déclin, l'ouvrage s'achève sur les conditions de sa revalorisation, impliquant une redéfinition de son contenu et de la relation législateur-juge.
La crise de la loi = Déclin ou mutation ? [texte imprimé] / Pierre ALBERTINI, Auteur . - LexisNexis, 2015 . - 366 pages ; Broché. - (Essais) .
ISBN : 978-2-7110-2216-8
Langues : Français (fre)
Catégories : Sources du droit et ouvrages généraux en droit Mots-clés : lois rédaction législative crise déclin mutation légistique notion de loi fonctions de la loi transformations enjeux finalités sécurité juridique stabilité accessibilité égalité liberté justice primauté volonté générale bloc de constitutionnalité subordination contrôle de conventionnalité élaboration de la loi évaluation préalable insuffisance travail parlementaire imperfections contenu de la loi accès à la loi application de la loi revalorisation de la loi Index. décimale : 348.440 2 : Lois et règlements - France Résumé :
Au coeur de toute société ordonnée, la réflexion sur la loi, longtemps imprégnée de considérations métaphysiques, apparaît, sous sa forme moderne, avec Montesquieu et Bentham : elle reçoit une consécration majestueuse avec la Déclaration de 1789. Pièce maîtresse de la "garantie des droits" jusqu'à la Ve République, elle est désormais concurrencée, partout, par le constitutionnalisme et, en Europe, par le droit communautaire. L'amélioration de la qualité de la loi, tant dans l'écriture que sur le fond, explique l'émergence d'une discipline nouvelle, la légistique, dont le statut-art ou science ? - divise la doctrine.
Déclin ou mutation de la loi ? Tel est le fil conducteur de l'ouvrage. Ce dernier replace d'abord l'évolution de la loi dans le cadre plus général de la transformation du droit, dont elle est l'un des outils. Les questionnements philosophique et juridique sur la finalité et les fonctions de la loi conduisent ensuite à en dresser la "pathologie" : surcharge de détails, perte de clarté, application malaisée dessinent une cartographie des insuffisances et des risques, sous l'angle de l'accès à la loi et de ses effets.
Malgré les progrès réalisés en 2008-2009, l'évaluation législative demeure largement perfectible, comme le montrent les nombreuses pistes ouvertes par l'auteur, qui s'inspire de son expérience personnelle et d'exemples étrangers significatifs (canadien, suisse, britannique). Concluant à la mutation de la loi et non à son déclin, l'ouvrage s'achève sur les conditions de sa revalorisation, impliquant une redéfinition de son contenu et de la relation législateur-juge.
RĂ©servation
RĂ©server ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© 1690 II 2015 ALB Livre CREDIMI 301 II - Sources du droit et ouvrages généraux en droit (ex. : pluralisme…) Disponible
Titre : Droit et modernité Type de document : texte imprimé Auteurs : Bruno OPPETIT, Auteur Editeur : Puf Année de publication : 1998 Collection : Doctrine juridique Importance : 304 pages Format : Broché ISBN/ISSN/EAN : 978-2-13-049329-7 Langues : Français (fre) Catégories : Sources du droit et ouvrages généraux en droit Mots-clés : philosophie modernité tendances droit strict relativisme droit étatique droit pluraliste droit émietté droit réunifié incertitudes primauté résultats matériels droit naturel systèmes normatifs Index. décimale : 340.115 : Droit et société Résumé : Cet ouvrage se propose de décrire les tendances considérées à travers certaines des manifestations les plus caractéristiques de la vie juridique, d'une société gagnée à la modernité et saisie par le doute. Les notions de droit et de modernité s'éclairent l'une et l'autre. D'un côté l'approche juridique fournit une grille d'analyse essentielle de la modernité tant la référence au droit lui paraît liée et imprègne la société moderne dans ses aspirations comme dans sa quotidienneté. Réciproquement seule la modernité rend intelligible un corps de règles disparates, contingentes, voire contradictoires qu'une analyse purement technique ne permet plus de pénétrer dans sa globalité ni dans ses ressorts profonds. La modernité exprime une vision du monde, à ce titre elle emporte à l'égard du droit des conséquences qu'on ne saurait réduire à la seule incidence des facteurs politique, moral et économique, selon la fresque qu'en avait autrefois brossé le doyen Ripert dans des ouvrages mémorables. On ne saurauit davantage l'ignorer en s'enfermant dans une conception purement formaliste et normativiste du droit. Ces pages s'inscrivent dans une réflexion sur le sens de l'évolution d'un système juridique dont les lignes de force n'apparaissent pas toujours très nettement en écho aux incertitudes de la modernité. Cet ouvrage s'efforce de mettre en lumière ces tendances multiples et d'en esquisser une explication Droit et modernité [texte imprimé] / Bruno OPPETIT, Auteur . - Puf, 1998 . - 304 pages ; Broché. - (Doctrine juridique) .
ISBN : 978-2-13-049329-7
Langues : Français (fre)
Catégories : Sources du droit et ouvrages généraux en droit Mots-clés : philosophie modernité tendances droit strict relativisme droit étatique droit pluraliste droit émietté droit réunifié incertitudes primauté résultats matériels droit naturel systèmes normatifs Index. décimale : 340.115 : Droit et société Résumé : Cet ouvrage se propose de décrire les tendances considérées à travers certaines des manifestations les plus caractéristiques de la vie juridique, d'une société gagnée à la modernité et saisie par le doute. Les notions de droit et de modernité s'éclairent l'une et l'autre. D'un côté l'approche juridique fournit une grille d'analyse essentielle de la modernité tant la référence au droit lui paraît liée et imprègne la société moderne dans ses aspirations comme dans sa quotidienneté. Réciproquement seule la modernité rend intelligible un corps de règles disparates, contingentes, voire contradictoires qu'une analyse purement technique ne permet plus de pénétrer dans sa globalité ni dans ses ressorts profonds. La modernité exprime une vision du monde, à ce titre elle emporte à l'égard du droit des conséquences qu'on ne saurait réduire à la seule incidence des facteurs politique, moral et économique, selon la fresque qu'en avait autrefois brossé le doyen Ripert dans des ouvrages mémorables. On ne saurauit davantage l'ignorer en s'enfermant dans une conception purement formaliste et normativiste du droit. Ces pages s'inscrivent dans une réflexion sur le sens de l'évolution d'un système juridique dont les lignes de force n'apparaissent pas toujours très nettement en écho aux incertitudes de la modernité. Cet ouvrage s'efforce de mettre en lumière ces tendances multiples et d'en esquisser une explication Réservation
RĂ©server ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© 1588 II 1998 OPP Livre CREDIMI 301 II - Sources du droit et ouvrages généraux en droit (ex. : pluralisme…) Disponible RĂ©servation
RĂ©server ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© 1715 VIII 2012 VOG Livre CREDIMI 301 VIII - Droit économique, droit du marché Disponible Permalink