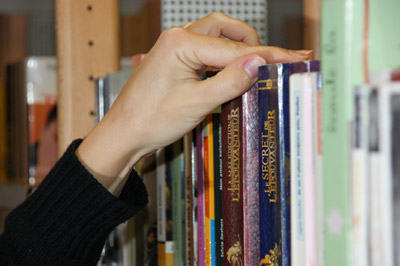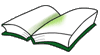Bibliothèque CREDIMI
DĂ©tail d'une collection
|
|
Documents disponibles dans la collection (19)


 Affiner la recherche Interroger des sources externes
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : Le siège de l’arbitrage international. Étude d’une autonomisation Type de document : texte imprimé Auteurs : PERNET, Martial, Auteur Editeur : LexisNexis Année de publication : 2020 Collection : CREDIMI ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7110-3404-8 Langues : Français (fre) Résumé : En matière internationale, le tribunal arbitral n’a d’autre choix que de se fixer, même fictivement, sur le territoire d’un État afin de rendre sa sentence.
Le choix de cet « État hôte » emporterait alors élection du siège, sorte de « domicile » de l’arbitrage international. Mais quel choix faire ? Comment ? Par qui ? Que faire en cas d’incertitude dans ce choix ? Quels effets cette fixation devrait-elle avoir ensuite lors de la création du tribunal, lors du rendu et de l’exécution de sa sentence, ou encore lors du choix des lois applicables ? Il n’est pas une réponse unique à ces simples questions : le droit de l’arbitrage international accordant une importance variable à la notion de siège.
La définition de la substance et de la portée de cette notion dépendra en effet de la place que l’on accordera à la justice arbitrale vis-à -vis de la justice étatique. C’est ainsi par l’étude des différents courants de pensée philosophique retenus par l’un ou l’autre des courants doctrinaux, qu’il sera possible de saisir les différentes représentations de la notion du « siège de l’arbitrage » qui existent au sein de la communauté juridique internationale.
Aussi ce manuscrit amènera-t-il à de profonds questionnements sur la source de la juridicité de l’arbitrage international. En effet, plus l’on considèrera que la sentence puisera sa source dans l’ordonnancement juridique de l’État dans lequel se situe le tribunal, plus l’on intégrera l’arbitrage et l’arbitre à cet ordonnancement juridique, et plus alors le droit du siège aura de prise sur le déroulement de la procédure arbitrale, l’organisation du tribunal, et la vie de la sentence. Ainsi, après l’étude des différentes conceptions de théorie générale du droit de l’arbitrage puis des représentations se rattachant à la notion du siège – étude au passage de laquelle il sera constaté une révolution de la théorie dominante, passant d’un modèle territorial à un modèle délocalisé, puis autonome – une analyse des conséquences de ce siège sur la procédure arbitrale amènera à un constat flagrant. Quelle que soit la théorie du siège de l’arbitrage envisagée, un net recul de l’impérativité des lois et décisions de cet État est à relever.
Le siège de l’arbitrage international. Étude d’une autonomisation [texte imprimé] / PERNET, Martial, Auteur . - LexisNexis, 2020. - (CREDIMI) .
ISBN : 978-2-7110-3404-8
Langues : Français (fre)
Résumé : En matière internationale, le tribunal arbitral n’a d’autre choix que de se fixer, même fictivement, sur le territoire d’un État afin de rendre sa sentence.
Le choix de cet « État hôte » emporterait alors élection du siège, sorte de « domicile » de l’arbitrage international. Mais quel choix faire ? Comment ? Par qui ? Que faire en cas d’incertitude dans ce choix ? Quels effets cette fixation devrait-elle avoir ensuite lors de la création du tribunal, lors du rendu et de l’exécution de sa sentence, ou encore lors du choix des lois applicables ? Il n’est pas une réponse unique à ces simples questions : le droit de l’arbitrage international accordant une importance variable à la notion de siège.
La définition de la substance et de la portée de cette notion dépendra en effet de la place que l’on accordera à la justice arbitrale vis-à -vis de la justice étatique. C’est ainsi par l’étude des différents courants de pensée philosophique retenus par l’un ou l’autre des courants doctrinaux, qu’il sera possible de saisir les différentes représentations de la notion du « siège de l’arbitrage » qui existent au sein de la communauté juridique internationale.
Aussi ce manuscrit amènera-t-il à de profonds questionnements sur la source de la juridicité de l’arbitrage international. En effet, plus l’on considèrera que la sentence puisera sa source dans l’ordonnancement juridique de l’État dans lequel se situe le tribunal, plus l’on intégrera l’arbitrage et l’arbitre à cet ordonnancement juridique, et plus alors le droit du siège aura de prise sur le déroulement de la procédure arbitrale, l’organisation du tribunal, et la vie de la sentence. Ainsi, après l’étude des différentes conceptions de théorie générale du droit de l’arbitrage puis des représentations se rattachant à la notion du siège – étude au passage de laquelle il sera constaté une révolution de la théorie dominante, passant d’un modèle territorial à un modèle délocalisé, puis autonome – une analyse des conséquences de ce siège sur la procédure arbitrale amènera à un constat flagrant. Quelle que soit la théorie du siège de l’arbitrage envisagée, un net recul de l’impérativité des lois et décisions de cet État est à relever.
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© 3166 collection CREDIMI Livre CREDIMI 301 Section à déterminer Exclu du prĂŞt Les sources du droit administratif global
Titre : Les sources du droit administratif global Type de document : texte imprimé Editeur : LexisNexis Année de publication : 2021 Collection : CREDIMI ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7110-3593-9 Langues : Français (fre) Résumé : Apparu aux États-Unis au milieu des années 2000, le "Global administrative law" est un projet de recherche visant à observer et à favoriser le développement de normes de type administratif au-delà de l’État : transparence des processus décisionnels internationaux, motivation des décisions, émergence de recours, etc. La doctrine du GAL part du postulat que le droit international classique, trop stato-centré, ne permet pas d'analyser ces phénomènes, et rejette en particulier la notion de source du droit. Une analyse des limites du GAL a conduit à faire émerger une nouvelle notion de "droit administratif global" en droit positif, fondée sur l'observation de l'activité des entités globales et dont l'administrativité est définie par un critère fonctionnel. L'étude a ensuite vérifié l'hypothèse selon laquelle ces normes, procédures et standards répondaient à des modes de formation identifiables. En s'appuyant sur le pluralisme institutionnel pour appréhender la structure de l'espace administratif global, il est sur ces bases proposé une théorie des sources formelles du droit administratif global. En enrichissant l'exposé de ses modes formels de création par une réflexion systémique sur leurs fonctions et leurs effets, il est finalement possible de définir le droit administratif global par ses sources : il s'agit de la branche de droit international visant à légitimer, par l'emprunt aux droits administratifs et en considération d'un principe d'apparences, les processus décisionnels globaux.
La thèse, qui constitue autant une réflexion sur le droit global que sur les modes de formation contemporains du droit international, confirme aussi la pertinence de certains outils classiques de la pensée juridique, à l'instar des ordres juridiques et des sources du droit.Les sources du droit administratif global [texte imprimé] . - LexisNexis, 2021. - (CREDIMI) .
ISBN : 978-2-7110-3593-9
Langues : Français (fre)
Résumé : Apparu aux États-Unis au milieu des années 2000, le "Global administrative law" est un projet de recherche visant à observer et à favoriser le développement de normes de type administratif au-delà de l’État : transparence des processus décisionnels internationaux, motivation des décisions, émergence de recours, etc. La doctrine du GAL part du postulat que le droit international classique, trop stato-centré, ne permet pas d'analyser ces phénomènes, et rejette en particulier la notion de source du droit. Une analyse des limites du GAL a conduit à faire émerger une nouvelle notion de "droit administratif global" en droit positif, fondée sur l'observation de l'activité des entités globales et dont l'administrativité est définie par un critère fonctionnel. L'étude a ensuite vérifié l'hypothèse selon laquelle ces normes, procédures et standards répondaient à des modes de formation identifiables. En s'appuyant sur le pluralisme institutionnel pour appréhender la structure de l'espace administratif global, il est sur ces bases proposé une théorie des sources formelles du droit administratif global. En enrichissant l'exposé de ses modes formels de création par une réflexion systémique sur leurs fonctions et leurs effets, il est finalement possible de définir le droit administratif global par ses sources : il s'agit de la branche de droit international visant à légitimer, par l'emprunt aux droits administratifs et en considération d'un principe d'apparences, les processus décisionnels globaux.
La thèse, qui constitue autant une réflexion sur le droit global que sur les modes de formation contemporains du droit international, confirme aussi la pertinence de certains outils classiques de la pensée juridique, à l'instar des ordres juridiques et des sources du droit.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© 3185 CREDIMI Livre CREDIMI 301 Section à déterminer Exclu du prĂŞt
Titre : Le soutien public au sport Type de document : texte imprimé Auteurs : Gérald SIMON, Auteur Editeur : LexisNexis Année de publication : 2012 Collection : CREDIMI ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7110-1696-9 Langues : Français (fre) Résumé : Le développement du sport, même s’il s’agit d’une activité privée exercée principalement sous la forme associative, est étroitement dépendant en France du soutien que lui apportent les personnes publiques.
Ce soutien se manifeste sous la forme bien connue des subventions accordées au mouvement sportif, mais aussi par des engagements non directement financiers, tels les nombreux équipements publics affectés à la pratique sportive, les agents publics placés auprès des groupements sportifs ou encore des établissements publics spécialement dédiés à la formation et à la recherche dans ce domaine.
On le voit, si l’exercice des activités sportives est principalement du ressort du mouvement sportif, les moyens pour l’accomplir relèvent largement des concours publics. C’est bien ce que veut entendre l’article L. 100-2 du Code du sport lorsqu’il énonce que « l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements (…) contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ».
Ce soutien public au sport est évidemment encadré par le droit : d’une part, par le droit communautaire qui, saisissant le sport comme activité économique, soumet les concours publics au régime strict des aides économiques, et d’autre part, par les principes qui gouvernent l’action publique et notamment l’intérêt général et l’égalité de traitement.
À cet encadrement juridique s’ajoute aujourd’hui le contexte de la crise économique et financière qui grève douloureusement les budgets des collectivités et, partant, leurs possibilités d’intervention, ce que traduit la diminution, parfois drastique, des moyens accordés au développement de l’activité sportive.
Cette septième « Rencontre du Droit du Sport » organisée par le Laboratoire de Droit du Sport est de dresser un inventaire des différentes formes d’interventions publiques en faveur du sport et de prendre la mesure, auprès des principaux acteurs engagés dans ce soutien et des spécialistes de la matière, des réalisations comme des difficultés dans la mise en œuvre de ce soutien public et, bien sûr, de son avenir.Le soutien public au sport [texte imprimé] / Gérald SIMON, Auteur . - LexisNexis, 2012. - (CREDIMI) .
ISBN : 978-2-7110-1696-9
Langues : Français (fre)
Résumé : Le développement du sport, même s’il s’agit d’une activité privée exercée principalement sous la forme associative, est étroitement dépendant en France du soutien que lui apportent les personnes publiques.
Ce soutien se manifeste sous la forme bien connue des subventions accordées au mouvement sportif, mais aussi par des engagements non directement financiers, tels les nombreux équipements publics affectés à la pratique sportive, les agents publics placés auprès des groupements sportifs ou encore des établissements publics spécialement dédiés à la formation et à la recherche dans ce domaine.
On le voit, si l’exercice des activités sportives est principalement du ressort du mouvement sportif, les moyens pour l’accomplir relèvent largement des concours publics. C’est bien ce que veut entendre l’article L. 100-2 du Code du sport lorsqu’il énonce que « l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements (…) contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ».
Ce soutien public au sport est évidemment encadré par le droit : d’une part, par le droit communautaire qui, saisissant le sport comme activité économique, soumet les concours publics au régime strict des aides économiques, et d’autre part, par les principes qui gouvernent l’action publique et notamment l’intérêt général et l’égalité de traitement.
À cet encadrement juridique s’ajoute aujourd’hui le contexte de la crise économique et financière qui grève douloureusement les budgets des collectivités et, partant, leurs possibilités d’intervention, ce que traduit la diminution, parfois drastique, des moyens accordés au développement de l’activité sportive.
Cette septième « Rencontre du Droit du Sport » organisée par le Laboratoire de Droit du Sport est de dresser un inventaire des différentes formes d’interventions publiques en faveur du sport et de prendre la mesure, auprès des principaux acteurs engagés dans ce soutien et des spécialistes de la matière, des réalisations comme des difficultés dans la mise en œuvre de ce soutien public et, bien sûr, de son avenir.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© 3114 collection CREDIMI Livre CREDIMI 301 Section à déterminer Exclu du prĂŞt
Titre : Sport et nationalité Type de document : texte imprimé Auteurs : Gérald SIMON, Auteur Editeur : LexisNexis Année de publication : 2014 Collection : CREDIMI ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7110-2183-3 Langues : Français (fre) Résumé : La nationalité est un des éléments fondamentaux qui gouvernent le sport : elle est étroitement attachée à la délivrance des titres sportifs (champion de France, champion du monde, etc.) tout comme elle conditionne le plus souvent l’accès aux épreuves dont la plupart sont réservées aux sportifs « nationaux ».
Mais de quelle nationalité s’agit-il ici ? Les fédérations dites nationales ne représentent pas toujours un État : les îles Féroé, rattachées au Danemark, sont pourtant membres de la FIFA et leurs équipes sont admises comme telles à participer aux compétitions internationales et européennes de football ; Tahiti, pour la même raison, a pu participer à la dernière Coupe des confédérations de football ; les sportifs natifs de l’île de Guam ou des Samoa américaines, toutes deux territoires des États-Unis, représentent ces deux « nations sportives » aux Jeux olympiques ou à la Coupe du monde de rugby et la fédération de quilles de Catalogne est un membre affilié de la fédération internationale, distinctement de la fédération espagnole ! En sens inverse, l’équipe de France de rugby a pu compter dans ses rangs un joueur de nationalité sud-africaine ! Quant à Monaco, le club de football participe au championnat de France tandis que l’équipe de bobsleigh représente la Principauté aux Jeux olympiques ! À quoi s’ajoute le traitement particulier en matière de naturalisation ou de double nationalité dont sont l’objet les sportifs dans nombre de disciplines. Ces quelques exemples démontrent que le mouvement sportif se sent affranchi du droit étatique pour poser ses propres règles en matière de nationalité. Cette liberté que s’accordent les institutions sportives fonde l’idée d’une « nationalité sportive » distincte et indépendante de la nationalité étatique, laquelle est pourtant un des attributs de la souveraineté. À quoi la « nationalité sportive » correspond-elle ? Et surtout dans quelle mesure son autonomie est-elle compatible avec les règles étatiques de la nationalité ? Quelques-unes des questions auxquelles s’efforcent de répondre les différentes contributions de cet ouvrage.Sport et nationalité [texte imprimé] / Gérald SIMON, Auteur . - LexisNexis, 2014. - (CREDIMI) .
ISBN : 978-2-7110-2183-3
Langues : Français (fre)
Résumé : La nationalité est un des éléments fondamentaux qui gouvernent le sport : elle est étroitement attachée à la délivrance des titres sportifs (champion de France, champion du monde, etc.) tout comme elle conditionne le plus souvent l’accès aux épreuves dont la plupart sont réservées aux sportifs « nationaux ».
Mais de quelle nationalité s’agit-il ici ? Les fédérations dites nationales ne représentent pas toujours un État : les îles Féroé, rattachées au Danemark, sont pourtant membres de la FIFA et leurs équipes sont admises comme telles à participer aux compétitions internationales et européennes de football ; Tahiti, pour la même raison, a pu participer à la dernière Coupe des confédérations de football ; les sportifs natifs de l’île de Guam ou des Samoa américaines, toutes deux territoires des États-Unis, représentent ces deux « nations sportives » aux Jeux olympiques ou à la Coupe du monde de rugby et la fédération de quilles de Catalogne est un membre affilié de la fédération internationale, distinctement de la fédération espagnole ! En sens inverse, l’équipe de France de rugby a pu compter dans ses rangs un joueur de nationalité sud-africaine ! Quant à Monaco, le club de football participe au championnat de France tandis que l’équipe de bobsleigh représente la Principauté aux Jeux olympiques ! À quoi s’ajoute le traitement particulier en matière de naturalisation ou de double nationalité dont sont l’objet les sportifs dans nombre de disciplines. Ces quelques exemples démontrent que le mouvement sportif se sent affranchi du droit étatique pour poser ses propres règles en matière de nationalité. Cette liberté que s’accordent les institutions sportives fonde l’idée d’une « nationalité sportive » distincte et indépendante de la nationalité étatique, laquelle est pourtant un des attributs de la souveraineté. À quoi la « nationalité sportive » correspond-elle ? Et surtout dans quelle mesure son autonomie est-elle compatible avec les règles étatiques de la nationalité ? Quelques-unes des questions auxquelles s’efforcent de répondre les différentes contributions de cet ouvrage.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© 3115 OUVRAGE CREDIMI Livre CREDIMI 301 Section à déterminer Exclu du prĂŞt